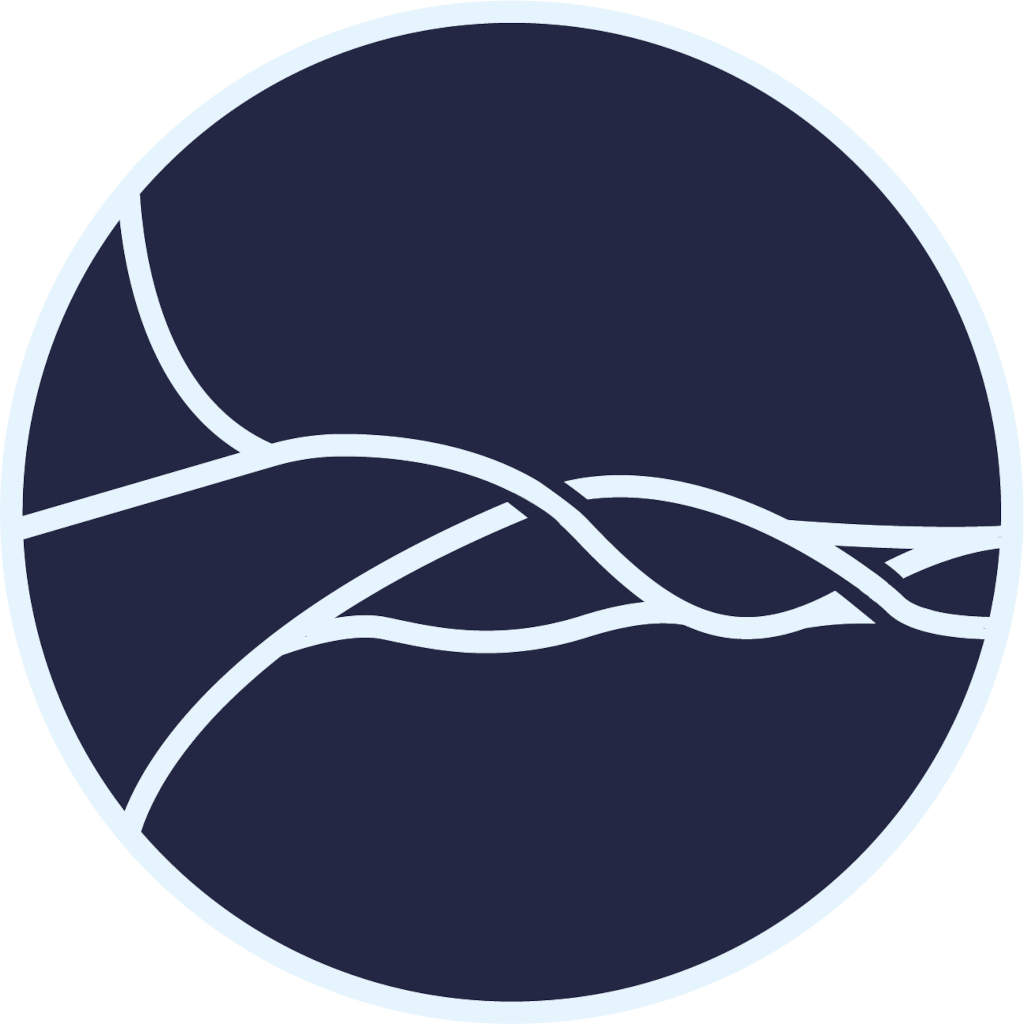Disjonction acromio-claviculaire
Dieppe (76) - Clinique Mégival

Qu’est ce que la Disjonction acromio-claviculaire ?
Chirurgie de l’épaule à Dieppe
La disjonction acromio-claviculaire correspond à une séparation entre l’acromion (partie de l’omoplate) et l’extrémité de la clavicule. Cela entraîne une perte de continuité entre ces deux structures articulaires, généralement après un traumatisme d’intensité variable.
Cette atteinte de type traumatique concerne souvent les personnes pratiquant une activité sportive, quel que soit leur niveau. Elle est plus fréquemment observée chez les pratiquants de sports de contact comme le rugby, les arts martiaux, ou encore chez les cyclistes et les conducteurs de deux-roues.
Il existe des classifications qui prennent en compte le nombre de ligaments touchés. Ces éléments orientent les choix de traitement, qui peuvent être fonctionnels ou chirurgicaux selon les cas. Le recours à la chirurgie n’est pas systématique.
Disjonction acromio-claviculaire à Dieppe
Docteur Poulain spécialiste de l'épaule
Évaluation préopératoire et démarche diagnostique
Le diagnostic repose sur un examen clinique précis. Celui-ci peut être rendu complexe dans un contexte douloureux, notamment en situation d’urgence.
La recherche d’un mouvement vertical anormal de la clavicule (signe de « touche de piano ») indique une rupture du ligament acromio-claviculaire. Une mobilité anormale d’avant en arrière suggère une atteinte des ligaments cléïdo-coracoïdiens.
La présence de la clavicule juste sous la peau, traduisant une effraction de la couche musculaire deltoïdienne, peut être facilement mise en évidence.
L’imagerie initiale comprend des radiographies standards de l’épaule (face et profil), ainsi qu’un cliché ciblé de l’articulation acromio-claviculaire. Cela permet également d’écarter d’éventuelles fractures associées (glène, apophyse coracoïde, humérus…).
Un scanner peut être demandé pour mesurer le déplacement de la clavicule vers l’arrière et vers le haut. Il permet de situer la disjonction dans l’un des quatre stades suivants :
- Entorse légère du ligament acromio-coracoïdien
- Entorse plus marquée du même ligament
- Stade précédent + rupture des ligaments cléïdo-coracoïdiens (conoïde et trapézoïde)
- Stade précédent + effraction de la chape musculaire deltoïdienne
Modalités de traitement
Dans la majorité des cas, les stades 1 et 2 sont traités sans recours à la chirurgie. Un repos d’un mois, suivi d’une rééducation de six semaines, permet généralement une évolution favorable. Une chirurgie peut être envisagée si les symptômes persistent après six mois de traitement conservateur.
Les stades 3 peuvent faire l’objet d’une proposition chirurgicale, notamment chez les personnes jeunes, celles qui pratiquent une activité physique régulière ou dont le travail est physiquement exigeant.
Les stades 4 relèvent d’une indication opératoire.
En phase aiguë (dans les trois premières semaines), l’intervention peut être réalisée par voie ouverte ou par arthroscopie. Cette dernière méthode limite les atteintes musculaires, ce qui facilite la récupération fonctionnelle. Elle est de plus en plus utilisée dans ce contexte.
L’intervention vise une stabilisation de l’articulation à deux niveaux : horizontal (par une broche) et vertical (grâce à un système de fixation interne avec fils et boutons d’ancrage).
La broche est retirée au bloc opératoire entre la quatrième et la sixième semaine suivant l’intervention.
Lorsqu’un traitement est envisagé plus de six mois après le traumatisme, une chirurgie à ciel ouvert est le plus souvent retenue. Cette intervention est plus longue et ne s’adresse pas à tous les patients (notamment en cas de surcharge pondérale).
Plusieurs techniques existent dans le cadre des disjonctions chroniques : elles visent à maintenir un lien mécanique entre la clavicule et l’acromion, mais les résultats sont généralement moins réguliers que ceux obtenus en phase précoce (moins d’un mois après le traumatisme).
Complications possibles
Comme pour toute chirurgie impliquant une articulation, des risques de raideur ou d’infection existent, bien que peu fréquents. L’approche arthroscopique contribue à limiter les risques infectieux.
Des retards de cicatrisation peuvent survenir, en particulier au niveau de la cicatrice sur la clavicule, mais ces effets sont habituellement transitoires.
Les complications générales liées aux interventions sur l’épaule sont détaillées dans la rubrique « Informations générales ».
Suites opératoires
L’intervention est réalisée en ambulatoire. L’hospitalisation a lieu en chambre individuelle ou partagée selon les disponibilités ou la préférence du patient. La sortie se fait le jour même vers le domicile, sans nécessité de séjour en convalescence.
Pendant l’hospitalisation, les soins et la surveillance sont assurés par les équipes médicale et paramédicale.
Un kinésithérapeute intervient avant la sortie pour expliquer les gestes autorisés, ceux à éviter, et les premiers mouvements d’auto-rééducation. Un document illustré est remis pour guider la suite à domicile.
Une écharpe est portée après l’opération, en particulier durant la première nuit. Dès le lendemain, aucune immobilisation prolongée n’est requise (pas d’attelle ni d’écharpe).
Pendant deux semaines, les soins de pansement sont assurés à domicile par une infirmière, un jour sur deux. Les fils utilisés sont résorbables.
Des médicaments contre la douleur peuvent être prescrits si nécessaire.
Un rendez-vous post-opératoire a lieu environ un mois après la chirurgie. À cette occasion, l’état des cicatrices, la souplesse de l’épaule et les symptômes généraux sont évalués. La date du retrait de la broche de stabilisation horizontale est fixée lors de cette consultation. Ce retrait se fait lors d’une hospitalisation très courte, en ambulatoire.
La rééducation débute ensuite, généralement à raison de trois séances par semaine. Elle se poursuit jusqu’à l’obtention d’une fonction jugée suffisante (souvent au bout d’un mois).
Le retour au travail dépend du type d’activité, et peut s’envisager entre quelques jours et quelques semaines. Pour le sport, un délai de 2 à 4 mois est habituellement nécessaire.
Évolution fonctionnelle attendue
L’intervention permet en général de retrouver une mobilité satisfaisante et peu ou pas de gêne dans les mouvements du bras et de l’épaule, en particulier pour les gestes impliquant des rotations ou des élévations latérales. La reprise des activités sportives sans contact est possible à partir de la quatrième semaine. Pour les sports avec contacts physiques, un délai de quatre mois est généralement observé.
La prise en charge est assurée par un professionnel de santé ayant une activité spécialisée dans les pathologies du membre supérieur. Ce professionnel reste l’interlocuteur de référence pour répondre aux questions et adapter les décisions en fonction de chaque situation.